| 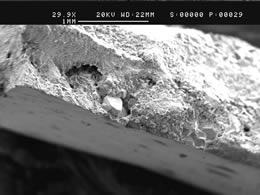  Introduction
: diagnostic, finalité et objectifs
Introduction
: diagnostic, finalité et objectifs
Il est traité ici plusieurs points clés de la caractérisation
et du diagnostic basés sur des démarches analytiques sur site
et/ou en laboratoire. Les rubriques ci-après concernent :
 Caractérisation
normative et réglementaire des pierres de carrières destinées
à� la construction contemporaine ;
 Caractérisation
de compatibilité des pierres des carrières visant à� être utilisées
dans le cadre d'un projet de restauration d'un édifice ou de réhabilitation
d'un bâtiment ;
 Caractérisation
des dégradations des pierres en oeuvre dans leur contexte originel
: reconnaissance, états d'altération et de conservation permettant
de proposer les procédés et protocoles les plus adéquats pour
la restauration envisagée.

 Caractériser
une pierre de carrière
Caractériser
une pierre de carrière
La réglementation de l'utilisation de la pierre dans la construction
exige de respecter plusieurs séries d'exigences retranscrites dans
la norme NF B 10-601, qui indique également les essais à� réaliser
en fonction de la destination dans l'ouvrage. Ces essais sont différents
en fonction de la situation de la pierre dans l'édifice car les
contraintes imposées par le milieu extérieur sont variables. Ces
contraintes sont majoritairement liées à� l'eau (capillarité, porosité,
gel -) mais également à� la fréquence de passage (usure, glissance -)
et aux caractéristiques mécaniques intrinsèques de la pierre (résistance
mécanique en compression et en flexion, rupture au niveau du goujon
de l'agrafe -).
 Les
prescriptions applicables, suivant la destination, sont regroupées
en cinq familles : Les
prescriptions applicables, suivant la destination, sont regroupées
en cinq familles :
 Pierre
naturelle massive,
 Revêtements
muraux collés,
 Revêtements
muraux attachés en pierre mince,
 Revêtements
de sol intérieur et extérieur hors voirie, scellé ou collé (sol
et escalier),
 Revêtements
de sol extérieur de voirie.
Les essais retenus permettant de caractériser la pierre, selon les
différentes destinations sont les suivants :
 Détermination
du coefficient d'absorption d'eau par capillarité selon la norme
NF EN 772-11
 Résistance
à� la compression selon les normes NF EN 1926 ou NF EN 772-1
 Détermination
des masses volumiques réelle et apparente, et des porosités ouverte
et totale selon la norme NF EN 1936
 Détermination
de la résistance au gel des éléments en pierre naturelle selon
la norme EN 12371
 Détermination
de la résistance à� la flexion sous charge centrée selon la norme
NF EN 12372
 Détermination
de l'effort de rupture au niveau du goujon de l'agrafe selon la
norme NF EN 13364
 Détermination
de la résistance à� l'usure selon la norme NF EN 14 157
 Détermination
de la résistance à� la glissance selon la norme NF EN 14 231
 Détermination
de la résistance aux chocs thermiques selon la norme NF EN 14
066
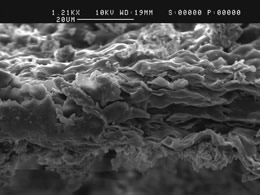 Une
prise en compte de la destination géographique de la pierre doit
également être effectuée. La gélivité est ainsi un des critères
les plus importants de mise en oeuvre du matériau. La carte de France,
détaillée par canton, comporte 4 zones de gel, prenant en compte
l'altitude, qui sont définies par les conditions suivantes : Une
prise en compte de la destination géographique de la pierre doit
également être effectuée. La gélivité est ainsi un des critères
les plus importants de mise en oeuvre du matériau. La carte de France,
détaillée par canton, comporte 4 zones de gel, prenant en compte
l'altitude, qui sont définies par les conditions suivantes :
 A
= gel très faible : pas plus de deux jours ayant atteint une température
inférieure à� -5 �C.
 B
= gel faible : pas plus de quatre jours ayant atteint une température
inférieure à� -6 �C.
 C
= gel modéré : pas plus de 10 jours ayant atteint une température
inférieure à� -10 �C.
 D
= gel sévère : plus de 10 jours ayant atteint une température inférieure à� -10 �C.
 Norme
NF B10-601, Juillet 2006, " Produits de carrières - Pierres
naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres
naturelles ", publication AFNOR Norme
NF B10-601, Juillet 2006, " Produits de carrières - Pierres
naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres
naturelles ", publication AFNOR
 "
Bien prescire la pierre en France ". Document Technique
- Editions ProRoc - 19p. - 2005 - Pierreactual "
Bien prescire la pierre en France ". Document Technique
- Editions ProRoc - 19p. - 2005 - Pierreactual |

 Rechercher
et sélectionner une pierre de substitution
Rechercher
et sélectionner une pierre de substitution
 Sur
la base d'une sélection géologique et d'une étude pétrographique
indispensables et primordiales et en parallèle des considérations
esthétiques, plusieurs méthodologies d'approche existent pour remplacer
les pierres en oeuvre trop dégradées pour être conservées. Sur
la base d'une sélection géologique et d'une étude pétrographique
indispensables et primordiales et en parallèle des considérations
esthétiques, plusieurs méthodologies d'approche existent pour remplacer
les pierres en oeuvre trop dégradées pour être conservées.
La détermination du numéro d'identification des pierres
calcaires est la plus ancienne et encore la plus utilisée et
la plus courante (issue de l'ancienne norme d'identification indexée
NF B 10-301, datant de 1975). Ce numéro est un outil de sélection
basé sur trois caractéristiques physiques. Ce numéro d'identification
I, compris entre 0,5 et 14, est déterminé à� l'aide de la formule
suivante :
oà�
V correspond à� la valeur moyenne de la vitesse de propagation
du son (m/s)
D correspond aux valeurs mini et maxi de la masse volumique
apparente (g/cm3),
R correspond à� la valeur médiane de la dureté superficielle
mesurée par la largeur de la rayure (mm). |
| Appellation |
Numéro
d'identification |
| Tendre |
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5
- 3 - 3,5 |
| Demi-ferme |
4 - 4,5 - 5 - 5,5 |
| Ferme |
6 - 6,5 - 7
- 7,5 |
| Dure |
8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10
- 10,5 |
| Froide |
11 - 11,5 - 12 - 12,5 -
13 - 13,5 - 14 |
|
Les essais à� réaliser sur les pierres prélevées sont donc : la détermination
de la masse volumique apparente, la mesure de la dureté superficielle
à� l'aide du scléromètre de Martens et la mesure de la vitesse de
propagation du son. Le tableau de correspondance entre les numéros
d'identification obtenus, et les appellations � tendre, demi-ferme,
ferme, dure et froide �, est le suivant :
Des travaux plus récents (Dessandier et al, 2002)
proposent une démarche à� la fois de compatibilité et de durabilité,
en déterminant un indice nommé IDC pour lequel les mesures à� réaliser,
en plus de la caractérisation pétrographique et minéralogique, sont
: la quantification des argiles hydrophiles, la mesure de la porosité,
de la résistance mécanique (échantillons secs et saturés) et des
coefficients d'absorption et de capillarité. Cette méthodologie
est à� retenir également mais reste aujourd'hui à� valider sur un
nombre de cas représentatif.
 En
complément de cette démarche de laboratoire, il est possible d'affiner
ces sélections par des investigations non destructives réalisées
en carrière. Il peut s'agir d'examens visuels accompagnés de mesures
de dureté superficielle, de vitesses du son et/ou d'auscultations
par réflectométrie radar. Cette dernière technique peut être comparée
à� une � échographie �, au sens médical du terme. l'analyse des échos
obtenus permet de visualiser et de localiser les éventuelles anomalies
qui sont reportées pierre par pierre. En
complément de cette démarche de laboratoire, il est possible d'affiner
ces sélections par des investigations non destructives réalisées
en carrière. Il peut s'agir d'examens visuels accompagnés de mesures
de dureté superficielle, de vitesses du son et/ou d'auscultations
par réflectométrie radar. Cette dernière technique peut être comparée
à� une � échographie �, au sens médical du terme. l'analyse des échos
obtenus permet de visualiser et de localiser les éventuelles anomalies
qui sont reportées pierre par pierre.
A l'issue, une cartographie des blocs auscultés permet de confirmer
la présélection des blocs ou d'écarter les matériaux présentant
des hétérogénéités marquées. Cette méthode permet de plus une traà�abilité
rigoureuse : suivi de l'échantillon lors de son passage en taillerie,
de son débit et enfin sur le chantier lors de la pose des pierres.
 Dessandier
D., Blanc A., Bromblet P., Mertz J-D., 2002, � Durabilité
et compatibilité des pierres des monuments : proposition d'une
méthodologie de sélection � - Revue Pierre Actual n �791, Juillet
2002, pp. 66-75 - Pierreactual Dessandier
D., Blanc A., Bromblet P., Mertz J-D., 2002, � Durabilité
et compatibilité des pierres des monuments : proposition d'une
méthodologie de sélection � - Revue Pierre Actual n �791, Juillet
2002, pp. 66-75 - Pierreactual |
|
